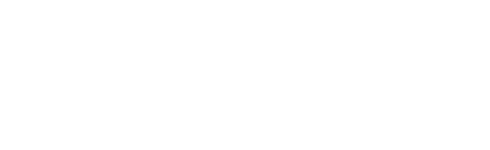Raneem Salah a toujours été fascinée par le cerveau, en particulier par sa remarquable capacité à se régénérer après une lésion. Mais c’est en découvrant le poisson zèbre, un petit poisson rayé capable de régénérer son tissu cérébral après un accident vasculaire cérébral, qu’elle s’est vraiment passionnée pour ce sujet.
« L’idée qu’un petit poisson puisse détenir la réponse à un défi médical aussi immense semblait presque trop belle pour être vraie », se souvient Raneem. « Je voulais explorer la possibilité d’utiliser ce qui se passe chez le poisson-zèbre pour inspirer un jour des traitements pour les humains. »
Cette curiosité a donné naissance à un projet de recherche qui l’a amenée à gérer des essais imprévisibles sur des poissons zèbres, à faire une présentation à l’Expo-sciences pancanadienne en 2024, puis à représenter le Canada à deux prestigieux salons scientifiques internationaux : le London International Youth Science Forum (LIYSF) et le MILSET Expo-Sciences International à Abu Dhabi en 2025.
Le défi de travailler avec des sujets vivants
Le développement de son projet pour l’ESPC s’est accompagné de défis uniques. Travailler avec des poissons zèbres vivants signifiait faire face à une imprévisibilité constante, gérer leur environnement, mener des essais et interpréter des données qui ne se comportaient pas toujours comme prévu.
« J’ai appris que la recherche est autant une question de patience que de découverte », réfléchit-elle.
Mais l’ESPC lui a offert quelque chose qui allait au-delà de la science elle-même. « J’avais l’impression d’entrer dans un monde où la curiosité régnait », se souvient Raneem. « Je me tenais devant mon panneau de présentation, entourée d’élèves tout aussi passionnés par leurs sujets. Lorsque les gens voulaient sincèrement en savoir plus sur mes recherches, cela me semblait irréel, comme si je n’étais plus seulement une étudiante, mais une jeune scientifique ayant quelque chose d’important à partager. »
Le moment où tout est devenu réel
Raneem n’a pleinement pris conscience de l’importance de représenter le Canada à l’échelle internationale qu’une fois arrivée à l’aéroport d’Abu Dhabi pour le MILSET. Encore sous le coup du décalage horaire, alors qu’elle attendait dans la file d’attente à la douane, elle a levé les yeux et a vu 35 personnes devant elle, toutes vêtues du même pull rouge d’Équipe Canada.
« C’est là que j’ai vraiment pris conscience de la situation. Je n’étais pas simplement un élève en voyage à l’étranger, je faisais partie de l’équipe canadienne », se souvient-elle. « J’ai souri et je me suis dit : « Wow, je suis vraiment ici. » » Je fais vraiment partie de cette équipe. » C’était un mélange surréaliste de fierté, d’excitation et d’incrédulité. Voir tout le monde réuni, représentant notre pays dans cette mer d’élèves internationaux, m’a fait réaliser à quel point cette opportunité était spéciale. »
Un autre moment inoubliable s’est produit lors d’une excursion à Cambridge pendant le LIYSF. En marchant dans les rues pavées entourées de siècles d’histoire, avec des élèves et des cyclistes qui passaient, Raneem a été frappée par la nature surréaliste de son voyage.
« J’étais là, à l’autre bout du monde, explorant une ville qui a été le théâtre de tant de progrès scientifiques, grâce à mes propres recherches », explique-t-elle. « Mon projet, qui a commencé par une simple curiosité en classe et des heures passées à étudier le poisson zèbre, m’avait amenée dans un lieu où la science est véritablement vivante. Ce jour-là, j’ai réalisé à quel point la passion et la persévérance peuvent vous mener loin. »
La science comme pont entre les cultures
Entrer au LIYSF, c’était comme entrer dans un groupe de réflexion mondial. Des élèves venus de partout, chacun avec son accent, son histoire et son rêve scientifique, se sont réunis autour d’un objectif commun. Le MILSET à Abu Dhabi a apporté une énergie différente, un riche échange culturel et un enthousiasme autour de l’innovation.
« On ne se rend pas compte à quel point la science est un langage universel tant qu’on n’a pas participé à ce genre d’événements », note Raneem.
Pour présenter son projet à l’international, elle a dû adapter son approche. À l’ESPC, la plupart des gens comprenaient déjà les bases du fonctionnement d’un AVC. Mais à l’international, elle a dû présenter les choses différemment.
« Je me suis moins concentrée sur la biologie complexe et davantage sur la narration : pourquoi le poisson zèbre est important, ce que la régénération signifie pour la médecine du futur et comment cette recherche touche les gens dans la vie réelle », explique-t-elle.
« L’impact de mes recherches n’était plus aussi clair, il était donc essentiel de m’assurer que mon public les comprenne. »
Elle s’est davantage appuyée sur des supports visuels et des analogies, comparant la guérison du cerveau du poisson zèbre à « l’activation d’un mode de réparation que les humains ont perdu ». Cette approche a permis de rendre la science accessible à tous, quelle que soit leur origine.
Les barrières linguistiques ont parfois rendu les conversations difficiles, en particulier lorsqu’il s’agissait d’expliquer des termes scientifiques à des élèves dont la langue maternelle n’était pas l’anglais. Mais Raneem a découvert quelque chose de profond : « malgré ces différences, il y avait toujours une sorte de « vecteur linguistique », et c’était la science elle-même », dit-elle. « La passion pour la découverte et la curiosité comblaient les lacunes de vocabulaire. Lorsque nous parlions d’expériences, de résultats ou d’idées, tout le monde comprenait l’enthousiasme qui les animait, même si les mots ne sortaient pas parfaitement. J’ai réalisé que la science avait cette incroyable capacité à connecter les gens au-delà de la langue ou de la culture. La curiosité est universelle ; elle n’a pas besoin d’être traduite. »
Apprendre à accepter ce que l’on ne sait pas
L’une des leçons les plus précieuses lui a été enseignée lorsque les juges et les autres élèves ont commencé à poser des questions techniques sur la signalisation génétique, un domaine qu’elle n’avait pas encore abordé dans ses recherches.
« J’ai eu un moment de panique, mais j’ai appris à admettre ce que je ne savais pas et à expliquer comment j’aimerais explorer ce sujet à l’avenir », se souvient Raneem. « Cette honnêteté m’a fait me sentir davantage comme une vraie scientifique que je ne l’aurais jamais été en faisant semblant. »
Cette expérience lui a révélé quelque chose d’important sur la confiance en soi. « Elle ne vient pas du fait de connaître toutes les réponses, mais d’être suffisamment curieuse pour continuer à poser des questions », réfléchit-elle.
Mais surtout, elle a découvert qu’elle aimait autant communiquer sur la science que la pratiquer. « C’est une chose de comprendre ses recherches, mais c’en est une autre de susciter l’enthousiasme des autres à leur sujet. »
Le pouvoir de la diversité culturelle dans la science
Ce qui a le plus surpris Raneem lors de l’expo internationale, c’est la diversité des idées et des approches. À l’ESPC, les élèves ont tous un parcours scolaire similaire. Mais à l’échelle internationale, elle a pu constater à quel point la culture influence la façon dont les gens perçoivent la science.
« Certains élèves abordaient les problèmes sous des angles complètement nouveaux en raison de la façon dont ils avaient été enseignés ou des ressources dont ils disposaient », explique-t-elle. « Cela m’a fait apprécier encore plus la créativité. »
Cette expérience lui a également appris à s’adapter, à lire l’ambiance, à simplifier des idées complexes et à trouver des moyens créatifs de rendre la science attrayante et accessible. Parfois, cela impliquait de remplacer des termes techniques par des métaphores ou de se concentrer davantage sur le « pourquoi » que sur le « comment ».
« Chaque conversation était différente, et je devais adapter mon approche en temps réel », explique-t-elle. « Cette expérience m’a appris que la capacité d’adaptation est l’une des compétences les plus précieuses qu’une personne puisse avoir, non seulement dans la recherche, mais aussi dans toute carrière future. »
Conseils aux futurs scientifiques
Raneem a de bons conseils à donner aux élèves qui se demandent s’ils doivent se lancer dans un projet STIM.
« Vous n’avez pas besoin de commencer avec une idée qui vaut des millions, il vous suffit d’avoir une question qui vous tient vraiment à cœur », souligne-t-elle. « Certains des meilleurs projets naissent d’une simple curiosité et d’une passion pour comprendre pourquoi quelque chose se produit. Lorsque vous vous intéressez à votre idée, cela vous aide à persévérer malgré les échecs, les nuits blanches et les résultats inattendus. »
Selon elle, le processus consiste moins à impressionner les autres qu’à découvrir quelque chose de nouveau, même si c’est juste pour soi-même. « Réaliser un projet STIM vous apprend bien plus que la science ; cela vous apprend la résilience, la créativité et la confiance en soi. » Vous apprenez à penser de manière critique, à communiquer vos idées et à voir la beauté dans le processus de résolution de problèmes. Lorsque votre curiosité vous mène vers quelque chose d’inattendu, vous réalisez que vous ne faites pas seulement un projet scolaire, mais que vous faites de la vraie science. »
Pourquoi les expos internationales sont-elles importantes ?
Raneem est convaincue que le Canada devrait continuer à envoyer des élèves à des expos internationales consacrées aux STIM (nous ne sommes peut-être pas tout à fait objectifs, mais nous sommes d’accord avec elle !).
« Ces expériences ne forment pas seulement de meilleurs scientifiques, elles forment des penseurs mondiaux », affirme-t-elle. « Lorsque les élèves canadiens participent à des événements tels que LIYSF ou MILSET ESI, ils partagent leurs recherches, mais surtout, ils représentent la curiosité, la créativité et la collaboration qui définissent notre pays. »
Rencontrer de jeunes scientifiques du monde entier lui a ouvert les yeux sur de nouvelles perspectives, cultures et façons de résoudre les problèmes. Toutes ces choses qu’elle n’aurait tout simplement pas pu apprendre en classe. « C’est incroyablement inspirant de voir comment un amour commun pour les STIM peut connecter des personnes au-delà des frontières et des origines. »
Pour Raneem, faire partie de l’Équipe Canada lui a appris que l’innovation prospère lorsque les idées sont échangées librement. « Ces expos ne se contentent pas de présenter des projets, elles façonnent littéralement les futurs leaders qui comprennent que la science est mondiale et que le progrès dépend de notre collaboration à tous. »
La science à chaque instant
Représenter le Canada à l’expo-science internationale a aidé Raneem à réaliser à quel point l’innovation menée par les jeunes peut être puissante, et son expérience a renforcé une vérité qu’elle porte désormais en elle.
« La science ne se fait pas seulement dans les laboratoires ; elle se fait dans les conversations, dans la curiosité, dans chaque moment où l’on se demande « et si ? » », réfléchit-elle. « Et faire partie d’une communauté mondiale qui croit aussi en cela ? C’est quelque chose que je porterai toujours en moi. »
De sa fascination initiale pour la régénération des tissus cérébraux chez le poisson zèbre à sa présence dans les rues de Cambridge, à l’autre bout du monde, le parcours de Raneem montre ce qu’il est possible de réaliser lorsque la curiosité rencontre l’opportunité. Son histoire nous rappelle que les meilleures questions scientifiques naissent souvent d’une véritable curiosité pour le fonctionnement du monde et que, parfois, même les plus petites créatures détiennent les plus grandes réponses.